
Jane Bowles – 1 : Je suis écrivain et je veux écrire
Jane Bowles
1917-1973
I
Jane Bowles a quitté notre monde le 4 mai 1973 à l’âge de cinquante-six ans. Elle a été enterrée anonymement sous le numéro 453-F au cimetière San Miguel de Malaga, Andalucia, España.
Vingt-trois ans plus tard, en 1996, une lectrice espagnole est choquée d’apprendre que les restes mortuaires de l’écrivaine américaine vont être jetés dans une fosse commune. Alertée à mon tour, je contacte le critique littéraire Patrick Kéchichian. Celui-ci fait paraître deux brèves dans Le Monde des Livres, à une semaine d’intervalle, en préambule à une éventuelle pétition. J’essaie de mobiliser quelques amis, mais courriers et coups de téléphone ne provoquent pas la mobilisation escomptée. Jane Bowles, la femme de Paul Bowles ? — s’étonne-t-on dans le Landerneau littéraire parisien. Non : Jane Bowles, « la plus grande prosatrice des Lettres américaines modernes » — dixit Tennessee Williams.
« Lutin génial, elfe rieur, joyeux, torturé », selon Truman Capote, Jane Bowles était un être fondamentalement original. Détours continuels, contradictions permanentes, son style est à la mesure de son génie : excessif du bout des doigts, frugale et insatiable à la fois.
Je suis écrivain et je veux écrire
Jane Auer est née à New York le 22 février 1917 au sein d’une famille bourgeoise d’origine juive hongroise. Elle a grandi à Woodmere, Long Island. Enfant unique, son père meurt l’année de ses treize ans. Deux ans plus tard, en 1932, sa mère l’envoie dans un sanatorium à Leysin, dans les Alpes vaudoises, pour soigner une tuberculose du genou droit.[1]
Jane passe deux ans en Suisse. Elle apprend le français, découvre la littérature de Gide, Proust, Montherlant et Louise de Vilmorin. Sur le paquebot du retour à New York, Jane Auer croise Louis-Ferdinand Céline… [2]
Jane a dix-sept ans quand elle annonce à sa mère : « Je suis écrivain et je veux écrire. »
Durant l’hiver 1937, Jane Auer rencontre Paul Bowles, un jeune musicien (né en 1910) aussi blond et diaphane qu’elle est brune et ténébreuse. Il aime les hommes, elle préfère les femmes. Ils se marient le 21 février de l’année suivante et décident aussitôt de s’accorder mutuellement une totale liberté. Le jeune couple part en voyage de noce : Mexico, Panama, Londres, Paris.
Pendant l’été 1940, au Mexique, les Bowles font la connaissance de Tennessee Williams.[3] Une amitié sans faille unira désormais Janie à Tenn qui l’accueille dans son harem de « femmes-monstres » (selon l’expression de Gore Vidal) aux côtés d’Anna Magnani et de Carson McCullers.
(Cf. La Série Tennessee Williams)
Le voyage en Amérique latine avec Paul « inspire » Jane pour son premier roman : Deux dames sérieuses. « Jane avait une peur terrible du mot inspiré, se souvient l’écrivain marocain Mohamed Choukri. Au commencement était le Verbe — cette expression la terrorisait. »[4]
Au printemps 1943, les éditions Knopf publie à New York le premier livre de Jane Bowles : Two Serious Ladies.[5] Les critiques jugent le texte incompréhensible.
À première vue, l’unique roman de Jane Bowles déconcerte par son apparence excentrique. L’écrivaine brésilienne Clarice Lispector met en garde le lecteur en ces termes : « Je serais heureuse qu’il soit lu uniquement par des personnes à l’âme déjà formée. Celles qui savent que l’approche de toute chose se fait progressivement et péniblement et doit parfois passer par le contraire de ce qu’on approche. »
Un journaliste américain écrit que celui ou celle qui tenterait de résumer l’intrigue de Deux dames sérieuses courrait droit à la folie.
Courons donc.
D’une part, Miss Goering vit recluse avec sa compagne, Miss Gamelon, au large de New York. « Miss Gamelon, assise dans le salon devant un âtre vide, songeait que toute la colère de Dieu était descendue sur sa tête. Le monde et les gens qui le peuplaient venaient soudain d’échapper à sa compréhension et elle se sentait devant le grand danger de perdre une fois pour toute l’univers dans sa totalité : sentiment difficile à expliquer. »
D’autre part, Mrs et Mr Copperfield voyagent en Amérique latine. « Ne peuvent être considérés comme vraiment mûrs que les hommes qui atteignent un stade leur permettant de se mesurer avec une seconde tragédie intérieure, et renoncent à affronter sans cesse la première », écrit Mr Copperfield à sa femme qui s’est éprise de Pacifica, une prostituée de Colon, sordide banlieue de Panama.
Que se passe-t-il exactement ? Qui sont ces gens ? Qu’est-ce qui les gouverne ? Une fois le livre fermé, le lecteur est dérouté. C’est qu’il s’agit non pas de lire simplement une histoire, délivrant plus ou moins un message, mais de partager une expérience intime au cours d’une virée improbable dans un univers aussi naïf qu’angoissant. Deux dames sérieuses n’est sans doute pas un « roman » au sens traditionnel et restrictif du terme, mais il est, sans conteste, un grand livre.
D’abord, c’est un texte original : rien n’a jamais été écrit ainsi (ni avant, ni depuis)[6]. Ensuite, c’est une comédie ; tragique, certes, mais hilarante (ce que les critiques ont toujours beaucoup de mal à envisager). C’est de ce hiatus entre la gravité d’un questionnement existentiel et l’incongruité des moyens employés pour y répondre — souvent ridicules, parfois sordides — que surgit l’humour inouï de Jane Bowles.
De toute part, le texte est jugé inepte et immoral.
Jane est dévastée, elle n’achèvera plus jamais aucun autre roman.
Plaisirs paisibles
Au début des années 40, Jane et Paul Bowles vivent en communauté à New York avec leurs « amours respectives ». C’est une époque faste et joyeuse. Jane écrit une pièce de théâtre : In the Summer House (qui restera inédite jusqu’en 1953).
En février 1946, Harper’s Bazaar publie une nouvelle de Jane Bowles : Plain Pleasures[7].
Alva Perry, veuve depuis onze ans, « digne et réservée, âgée d’une quarantaine d’années », habite seule la maison de son oncle divisée en appartements. John Drake, routier, célibataire, « personnage discret et peu communicatif », occupe le studio en dessous de chez elle. Depuis des années qu’ils vivent l’un sur l’autre, les deux solitaires ne se sont jamais adressés la parole.
Un soir, Mrs Perry décide de faire rôtir quelques pommes de terre dans l’arrière-cour. Après l’avoir aidée à porter son sac de patates, Mr Drake se joint à Mrs Perry pour les déguster. « Ne pensez-vous pas que les plaisirs paisibles sont plus proches du cœur de Dieu ? » lui demande-t-elle. Pour toute réponse, Mr Drake l’invite au restaurant. « Ils arrivèrent à la moitié de leur repas sans avoir échangé le moindre propos. Mr Drake avait commandé une bouteille de vin doux et quand Mrs Perry eut vidé son second verre, elle finit par dire : Je crois qu’on se fait rouler dans les restaurants. »
À la fin du dîner, Mrs Perry, ivre morte, se lève sans un mot pour son compagnon, traverse la salle à manger, monte à l’étage de l’établissement en titubant, ouvre la porte d’une chambre et s’endort « à plat ventre, le chapeau sur la tête. » Pendant ce temps-là, Mr Drake l’attend en bas, seul à table. Mrs Perry ne réapparaissant pas, dérouté, il s’en va.
Le lendemain, rien n’a changé : les deux solitaires se croisent sans se parler. Et pourtant, dorénavant, Mrs Perry s’endormira en murmurant : « John Drake, mon doux John Drake. »
Que s’est-il passé pendant la nuit ? L’auteur ne le dit jamais.
Dans sa biographie de Jane Bowles, Millicent Dillon[8] suggère que Mrs Perry a été violée par le propriétaire du restaurant dans la chambre duquel, complètement saoule, elle s’était réfugiée.
Le 31 janvier 1948, Jane rejoint Paul installé depuis peu à Tanger. Là, elle tombe folle amoureuse de Chérifa, une jeune paysanne originaire de l’Atlas qui vend du blé dans un hanootz (petite échoppe) du marché aux grains. Chérifa ne parle ni français, ni anglais. Jane apprend l’arabe maghrébin (et notamment le Darija, dialecte marocain).
En mai, au cours d’une villégiature à l’hôtel Belvédère de Fès, Paul — qui s’est mis à écrire sous l’influence de sa femme — achève Un Thé au Sahara. Jane, quant à elle, travaille à sa plus longue nouvelle : Camp Cataract.
Camp Cataract est le chef d’œuvre de Jane Bowles. Comment transmettre le génie de ce texte sans le polluer, ni le réduire ? Comment traduire ce style volatil, burlesque, incongru ? Ces émotions suspendues… Tel le souvenir d’un rêve se dissipant quand nous voulons le retenir, Camp Cataract se dérobe à tout commentaire.
À l’instar de tous les textes de Jane Bowles, c’est une histoire de femmes.
Les femmes de Jane Bowles ne sont ni aguichantes, ni maternelles. Visionnaires aveuglées par la lumière, elles s’affranchissent héroïquement de l’ultime soumission : celle de la séduction. Leur « petite idée du salut », c’est l’inconnu ; l’abîme qu’il faut traverser entre soi et l’autre. « Je suis à la merci » répétait Jane qui reprenait volontiers à son compte l’ultime réplique de Blanche DuBois dans Un tramway nommé désir : « Whoever you are, I have always depended on the kindness of strangers. »[9]
En juillet 1948, Paul Bowles retourne à New York afin de composer la musique d’une pièce de Tennessee Williams : Été et fumée. Jane reste seule à Tanger. Elle séjourne à l’hôtel Villa de France (dans la Ville Nouvelle, derrière le consulat français) et passe ses journées au marché aux grains auprès de Chérifa ou, plus exactement, « à la lisière… »[10]
En décembre, Paul rentre à Tanger avec Tennessee et Frank Merlo. Tenn se souvient de ses retrouvailles avec Janie : « une jeune femme d’allure charmante, petite, piquante, qui passait avec la plus grande vivacité de l’humour à l’angoisse, de l’amour à l’affolement (…) Son indécision naissait d’un authentique souci de ne pas provoquer un faux mouvement dans un monde qui n’était que trop enclin, selon ses justes conjectures, à tourner de travers.[11] »
Durant l’hiver 1949, les Bowles traversent le Sahara jusqu’à Taghit, en Algérie.
En plein désert, Jane écrit Un bâton de sucre d’orge vert[12] qui nous conduit dans le monde intérieur de l’enfance solitaire. La nouvelle était la préférée de Tennessee Williams, il fera tout pour qu’elle soit publiée.
Ce texte est le dernier que Jane Bowles ne finira jamais.
Fin de l’épisode 1
Suite et fin, épisode 2 : J’ai peut-être dit tout ce que j’avais à dire
[1] Suivront plusieurs opérations qui la laisseront handicapée. Jane Bowles claudiquera toute sa vie.
[2] Je raconte l’anecdote dans Une histoire de Jane Bowles (éd. du Seuil, 2015).
[3] Cf. Une histoire de Jane Bowles, op. cit.
[4] Paul Bowles, le reclus de Tanger, Mohamed Choukri (éd. Quai Voltaire / La Table Ronde, 1997).
[5] Traduit en français par Jean Autret sous le titre Deux dames sérieuses (éd. Gallimard, 1969) ; réédité en 1986 chez Christian Bourgois (coll. « 10/18 »).
[6] Ou, plus justement : je n’ai jamais rien lu de tel avant ni depuis.
[7] Repris dans le recueil éponyme édité à Londres en 1966 par Peter Owen ; traduit en français par Claude-Nathalie Thomas sous le titre Plaisirs paisibles, (éd. Christian Bourgois, coll. « 10/18 », 1986).
[8] A Little Original Sin. The life and work of Jane Bowles (éd. Holt, Rinehart and Winston, 1981) traduit par Michèle Causse sous le titre : Jane Bowles, une femme accompagnée (éd. Deuxtemps-Tierce, 1989).
[9] « Qui que vous soyez, j’ai toujours dépendu de la gentillesse des étrangers. »
[10] Cf. Une histoire de Jane Bowles, op. cit.
[11] In : Stèle de Jane Bowles, textes traduits et présentés par Michèle Causse (éd. Le Nouveau Commerce, 1978).
[12] A Stick of Green Candy, publié dans Vogue le 15 février 1957, repris dans le recueil Plain Pleasures, op. cit.



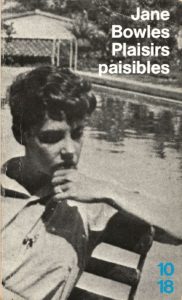



passion aussi pour cette écrivaine, merci, encore un épisode passionnant.
Quel feu ! Grand merci pour ce récit envoûtant.
Oh que c’est court ! Felicie vous nous faites languir !
🙏Que le temps vole jusqu’à mardi prochain !🙏
Merci Félicie pour ce nouvel épisode.
Roffinella a raison de dire que le récit est envoûtant.
Ça tient au personnage, c’est sûr ! Ça tient aussi à l’écriture ! Formidable!
Pour passer encore un peu de temps avec Jane BOWLES, je vous recommande « Une histoire de Jane Bowles » toujours sous la même plume au SEUIL.
Envoûtement garanti !